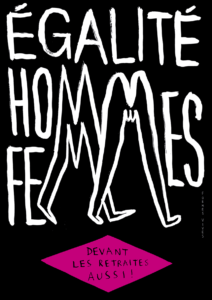
Certaines personnes cochent à regret M. ou Mme sur les formulaires administratifs si elles ne peuvent pas faire autrement, ou oublient de le faire délibérément, avec le sentiment que les catégoriser c’est les enfermer.
Ce sentiment peut surgir très tôt dès l’enfance. Être désigné comme “il” ou “elle”, implique, même sans les exprimer explicitement, des normes et un comportement socialement construits, et intériorisés malgré nous. D’où l’entrée dans le dictionnaire en ligne Le Petit Robert du pronom “iel” encore très peu usité, mais répondant à une nécessité d’exprimer une identité non binaire chez certain·es.
Pourquoi un pronom neutre contrarie-t-il tant les tenant·es d’une langue française standard de référence (des académicien·nes, et notre ancien et très peu regretté ministre de l’Éducation…) qui défendent un purisme qui ne colle pas au réel ? Les pronoms genrés n’existent pas dans toutes les langues, comme par exemple le Finnois, sans que cela ne dérange. Et la langue appartient d’abord aux personnes qui la parlent. S’emparer d’un pronom neutre, tout comme choisir des mots épicènes et adopter une écriture inclusive (1), c’est donc affirmer une non hiérarchisation, car si “ils” désignent tous les êtres humains, la formulation cependant, invisibilise toutes les “elles”. De là à penser que si on abolit le genre pour désigner des personnes, cela réduirait les discriminations sexistes, il n’y a qu’un pas…
Dans le monde anglophone
En parallèle, notons l’existence d’une discrète révolution depuis quelque temps dans les pays de langue anglaise. Les féministes américaines des années 70 ont adopté l’appellation Ms. (Mizz) pour ne pas indiquer leur statut de célibataire ou femme mariée (Miss ou Mrs.), puisque cette distinction n’existe pas pour les hommes, pour qui on écrit Mr. quelle que que soit leur situation. Un·e citoyen·ne américain·e peut opter pour X (genre neutre) au lieu de masculin (M), ou féminin (F), sur son passeport (les USA sont le 17ème pays à avoir introduit des passeports neutres). Des personnes non binaires demandent – avec plus ou moins de succès – qu’on les désigne par le pluriel “they” et “them”. Les entreprises utilisant l’anglais comme langue principale d’échange, comme la compagnie aérienne Virgin Atlantic par exemple, proposent à leur personnel, ici hôtesses et stewards (ainsi qu’aux passager·es), de porter un badge avec le pronom qui leur convient le mieux : They/Them, She/Her, He/Him. Certaines entreprises laissent le choix de toutes les combinaisons possibles She/Them…, pour signer courriers et courriels, ou même de ne rien inscrire sur leur badge, dans un souci de communication envers ses collaborateur·trices. Donner une meilleure image, favoriser diversité et inclusion, n’est-ce pas un moyen de gagner l’adhésion et donc d’accroître la productivité de ses employé·es ? Dans le passé des licenciements de partisan·es de l’inclusion ont eu lieu dans certains services du gouvernement britannique, et jusqu’au sein de la BBC. Assistons-nous donc aujourd’hui à un progrès réel et sincère, correspondant à l’évolution des mentalités ?
Le succès des badges ne fait aucun doute cependant, 10 000 sont déjà prêts à être distribués dans les avions de Virgin Atlantic, et le stock est épuisé, même si leur utilisation est facultative. Une seconde commande a dû être passée, ceci sans que personne ne s’en émeuve, contrairement à l’incompréhension lorsque la très traditionnelle chaîne de magasins britanniques Marks & Spencer a voulu faire de même l’année dernière.
Encore des réticences
Le mot “woke” qui ne correspond en réalité à aucun courant de pensée, mais a été inventé par les conservateur·trices afin de mettre fin à toute discussion face à des adversaires plus progressistes (accuser de wokisme permet de ne plus argumenter ou débattre sur le fond) vient tout de suite à l’esprit pour désigner la réaction négative voire très hostile, face à cette nouvelle utilisation des pronoms. Des grammairien·nes rétorquent aussi que puisque “they” et “them” sont pluriels, il est impossible de les utiliser pour désigner un seul individu (2).
D’autres personnes estiment que cela est une victoire pour la reconnaissance de l’identité de genre, tandis qu’un troisième groupe sans condamner ouvertement, soulève le problème d’une pression pour s’adapter à une nouvelle pratique du politiquement correct imposé par les services de Ressources humaines dans les entreprises, et obligeant les collaborateur·trices à surveiller leur formulation pour ne pas faire d’erreurs.
La polémique n’est donc pas close et de temps à autres, des messages indignés fusent sur les réseaux sociaux. Des employé·es de supermarché au Royaume-Uni ne portent pas de badge malgré l’opportunité offerte, en raison d’agressions homophobes dans leur quartier. Vouloir être désigné·e de façon neutre, n’est-ce pas se mettre à part et s’étiqueter ? Oui tant que cela ne concerne qu’une petite proportion de la population. L’idée que notre être biologique peut ne pas correspondre à notre identité doit donc encore faire son chemin. Un être se construit tout au long de la vie et des doutes peuvent l’assaillir face à une incompréhension générale. Obtenir le soutien de la société en acceptant tout le monde tel qu’iel est, est donc vital. Le besoin de pronoms neutres, même s’il semble ridicule ou accessoire pour certain·es, se fait ressentir à mesure que le concept d’identité de genre est adopté. Leur utilisation doit donc se diffuser puis se généraliser afin qu’aucun stigmate ne leur soit attaché. Seule l’histoire de la langue, en parallèle avec les idées qu’elle reflète, nous dira si ces pronoms sont adoptés.
Véronique Cozzupoli
(1) Depuis des années, certaines publications, journaux et magazines de langue anglaise, choisissent indifféremment he ou she pour le pronom générique se référant à une personne. Plus rarement la typographie abrégée s/he pour signifier he or she est adoptée.
(2) Le premier usage de “they” comme singulier est pourtant déjà attesté en 1375 dans un poème William and the Werewolf d’après l’Oxford English Dictionary.
