C’est une série d’émissions de France Culture, dans “La série documentaire”, disponible en podcast. Au cours des quatre épisodes, Johanna Bedeau et Angélique Tibau construisent un documentaire humain, historique, et critique de la place du médecin dans l’avortement.
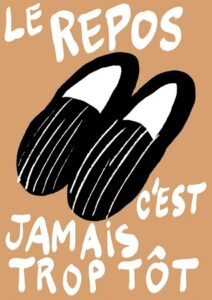
Les journalistes portent aussi, au cours de tous ces épisodes, la parole de nombreuses femmes qui ont avorté, Christiane dans les années 1950, Marie dans les années 1970 puis Aïssatou et d’autres à l’époque actuelle. Ces témoignages rendent à la fois compte de la réalité des avortements, différents mais avec le point commun de la volonté pour ces femmes de ne pas poursuivre leur grossesse, et ils permettent de voir la place de l’avortement dans la société.
Du cintre à la canule
Olivier Bernard, ancien président du MLAC (Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception) de Grenoble, fait partie de ces étudiant·es en médecine qui ont découvert les conséquences terribles des avortements pratiqués dans les années 1970, qui étaient invasifs, faits clandestinement : “Pendant mes études, j’ai fait mon stage d’externat en réanimation médicale. Et là, ça a été le choc de constater qu’en 1972, les services de réanimation médicale étaient peuplés majoritairement de jeunes femmes qui étaient là entre la vie et la mort. J’ai été bouleversé du mépris du jugement du corps médical par rapport à elles. On laissait entendre qu’elles l’avaient bien cherché”. Contre l’avis des pontes de la médecine académique, des étudiant·es vont se former à la méthode Karman, en Angleterre. Ils·elles ont ensuite formé des médecins, des infirmier·es et des femmes qui n’étaient pas dans le milieu médical. La technique “importée”, utilisant des canules, beaucoup moins risquée pour les femmes, était réalisable à domicile, équipé·es d’une valise contenant le matériel. L’avortement était principalement une affaire de sororité et de fraternité, Anne Joubert, militante du MLAC souligne qu’elle n’avait pas peur et qu’elle était persuadée d’être dans son droit, même si ce n’était pas légal.
La légalisation de l’avortement et la clause de conscience
Le vote de la loi autorisant l’avortement, la loi Veil en 1975, a légalisé l’avortement mais a aussi entraîné sa médicalisation. “Au moment du vote de la loi, la majorité du corps médical était opposée à l’avortement et nataliste. Et c’est pour ça que la loi de 75 a été votée. En confiant l’avortement aux médecins, on pensait qu’ils allaient pouvoir les dissuader d’avorter. Il y avait toujours cette mentalité nataliste” précise Michèle Ferrand, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Aussi, la loi place à part l’interruption volontaire de grossesse dans la médecine, en ajoutant une clause de conscience. Celle-ci permet à chaque médecin de ne pas pratiquer d’avortement mais l’oblige à envoyer une femme voulant avorter vers un·e collègue qui le pratique. Cette clause montre que l’IVG n’est pas un acte ni un droit comme les autres, et cela a un effet symbolique fort. En effet, tous les médecins ont déjà le droit à une clause de conscience pour leur permettre de ne pas effectuer un soin. Par contre, on n’imaginerait pas créer une clause de conscience pour les cardiologues (en plus de la clause générale) qui leur permettrait de refuser de soigner des patient·es ayant un infarctus mais ayant fumé toute leur vie.
En plus, la clause de conscience crée des désorganisations importantes des centres d’avortement, dans un contexte où, encore en 2017, jusqu’à un·e gynécologue sur deux l’invoque lors de l’embauche, dit Marie-Laure Brival de la maternité des Lilas. Il est difficile d’organiser les plannings des avortements lorsqu’il faut faire coïncider les emplois du temps de tous les intervenant·es (anesthésistes, infirmier·es, etc.), en sous-effectif et pour certain·es invoquant la clause de conscience. Ainsi, à Bailleul-sur-Sarthe en 2019, il y a eu une interruption de neuf mois de la pratique des avortements suite à ces dysfonctionnements !
C’est pourquoi, des médecins, des directrices de services, des chercheuses, le planning familial affirment maintenant qu’il est nécessaire de supprimer la clause de conscience pour que les avortements fassent entièrement partie de la santé des femmes et qu’ils soient reconnus comme acte de santé public. En allant plus loin, on peut affirmer que de ne pas faire d’avortement pourrait être considéré comme de la non-assistance à personne en danger, l’OMS soulignant que la santé n’est pas seulement physique mais aussi mentale.
Véronique Séhier, co-présidente du Planning familial, affirme ainsi : “La clause de conscience doit être supprimée, c’est un frein actuellement et ce qu’elle veut dire c’est que ce n’est pas aux femmes de décider”. La clause de conscience est ainsi une manière pour le corps médical de vouloir garder un contrôle : la remettre en cause, c’est repositionner le médecin en celui qui donne le soin et pas en celui qui décide le soin.
L’avortement, encore un parcours de la combattante

Chacun·e d’entre nous a écouté, vu, lu des témoignages des femmes ayant avorté avant la légalisation mais encore aujourd’hui l’avortement est difficile d’accès par différents aspects. Lors de rénovation des maternités, le centre IVG est souvent oublié, comme à Port-Royal à Paris, où il a fini par être mis au fond du couloir, à la place d’un service administratif. On compte 5 à 10 lieux pratiquant l’avortement qui ferment ou sont regroupés par an, ce qui oblige les femmes à parcourir jusqu’à 80 km pour avoir accès à un centre. Les fermetures de maternités sont aussi les suppressions de lieux de pratique des avortements. Sophie Gaudu, gynécologue, explique pourtant qu’il est facile de calculer, pour une population donnée, combien il y aura d’avortements et de définir l’offre de soin en fonction. Dans un sens, c’est comme si le fait de ne pas organiser l’accès à l’avortement, permettrait de faire baisser le taux d’avortement, ce qui n’arrive pas.
Plusieurs médecins questionnent aussi le délai légal d’avortement, qui poussent des femmes à partir dans l’urgence pour aller avorter dans des structures privées des pays limitrophes à la France, payant entre 500 et 1500 e à celles-ci et devant prendre en charge les coûts de transport. C’est ainsi, qu’Aïssatou, a dû faire ce parcours pour avorter, hors délai légal, parce qu’elle était sous emprise de son conjoint violent qui voulait qu’elle poursuive la grossesse. Ne serait-on pas revenu à une situation antérieure à 1975 ?
Le choix des femmes
Marie-Laure Brival, de la maternité des Lilas, explique qu’il faut arrêter de penser le monde de manière manichéenne, c’est bien, c’est mal : la contraception c’est bien. Ce sont les mêmes femmes qui, durant leur vie, se contraceptent, avortent et ont un enfant. L’avortement ne doit pas être l’envers négatif de la contraception, parce que celle-ci n’est jamais parfaite et aussi parce que le désir de grossesse est ambivalent. À la maison des femmes de Seine-Saint-Denis, les femmes sont accueillies pour suivre leur grossesse, avoir une contraception, avorter et accoucher.
Pour aller plus loin, la stabilisation du nombre d’avortements par an depuis de nombreuses années s’explique par le fait que les femmes ont des enfants plus tard (à 30 ans maintenant contre 25 ans en 1975) alors que l’âge du premier rapport sexuel ne change pas, donc il y a cinq ans de plus lors desquelles les femmes sont fécondes où elles peuvent facilement tomber enceinte et désirer interrompre leur grossesse. L’avortement dans ces cas peut être perçu comme une façon de se plier à la norme procréative actuelle de ne pas avoir d’enfant avant 30 ans.
Cette série documentaire fourmille de témoignages et d’analyses qui ne sont ici que partiellement retranscrits. Ils permettent de montrer les limites de la loi Veil, l’insuffisance de la mise en place des centres d’avortement, de l’enseignement de ces techniques lors des études de médecine mais aussi l’insuffisance de la prise en compte de la liberté des femmes à faire leur choix. Alors, c‘est maintenant à vous de vous plonger dans ce documentaire et écouter ces femmes !
Marine Bignon